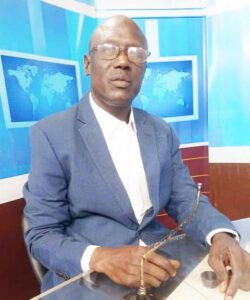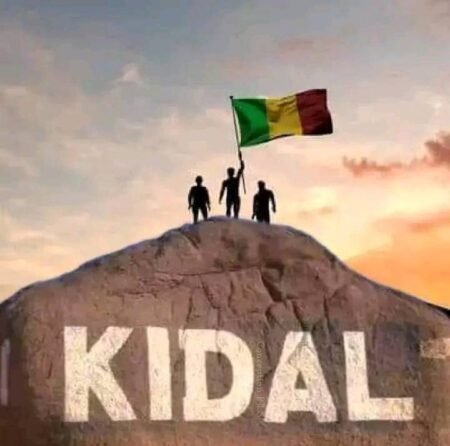Longtemps présentée comme un artisan de la paix au Sahel, notamment au Mali, l’Algérie tourne le dos à cette image en promulguant, le 27 juillet, une loi sur la mobilisation générale. Par cette décision, l’Algérie dévoile le visage d’un État prêt à entretenir le désordre qu’elle prétend conjurer. Derrière les discours de souveraineté et de dialogue, c’est bien une logique d’escalade permanente que consacre ce texte, au détriment de la paix régionale comme de la confiance aux frontières. En clair, en lieu et place de messages de paix et d’assurance, le régime algérien affiche la pression et la menace.
Dans un contexte régional marqué par une polarisation croissante de l’insécurité, la décision d’Alger de franchir ce nouveau seuil législatif interroge, voire inquiète. Publiée au Journal officiel et entrée en vigueur ce dimanche 27 juillet, la loi sur la mobilisation générale introduit une nouvelle architecture sécuritaire qui prévoit le passage de l’état de paix à l’état de guerre.
Le choix du moment n’est pas neutre. La promulgation de cette loi intervient après l’échec manifeste de l’Algérie à s’imposer comme médiateur auprès des nouvelles autorités maliennes. Lors d’une interview accordée à des médias de son pays, le président TEBBOUNE a été sans équivoque au sujet de notre pays en affirmant sa disponibilité d’œuvrer pour la paix au Mali, malgré la dénonciation de l’Accord d’Alger en janvier 2024.
Comme une réponse du berger à la bergère, le président Assimi GOITA, recevant le projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation au Mali, a affirmé que désormais les problèmes maliens seront gérés avec les solutions locales sans aucune influence extérieure en se fondant sur l’échec des différents accords.
«Nous avons pris nos responsabilités en lançant le dialogue inter-maliens, pour construire une paix sincère et durable entre Maliens», a déclaré le président de la transition, avant d’inviter les groupes armes rebelles, malgré leur alliance avec les terroristes, à se désarmer et à rejoindre le processus de la paix.
«Celui qui sait qu’il est Malien et qui veut la paix et la réconciliation, s’il est armé, doit d’abord se débarrasser de son arme et venir vers nous pour qu’on discute. Il y a beaucoup d’interlocuteurs : les chefs de villages, les maires, le ministre de la Réconciliation, la commission dialogue inter-maliens. Tous ceux qui veulent la paix, doivent se débarrasser de leur arme et venir vers nous pour qu’on discute de la paix», a poursuivi Assimi GOÏTA.
Ainsi, avec le refus du président Assimi GOÏTA d’accueillir l’initiative de médiation proposée par Abdelmadjid Tebboune, le faiseur de paix s’est vu marginalisé. Signe que l’influence tant vantée de l’Algérie sur le Mali s’affaiblit au profit d’autres pays jugés sincères dans leur démarche et soutien en faveur de la paix et de la sécurité au Sahel.
Sinon, comment comprendre que l’Algérie qui œuvre pour une stabilité au Mali et au Sahel se permet d’offrir « gîte et couvert » aux terroristes et aux séparatistes, alors qu’elle ne cesse de clamer l’unité du Mali.
Dans ce climat de défiance, la loi sur la mobilisation générale apparaît comme une riposte institutionnelle, traduisant le passage d’une posture diplomatique à une logique de puissance sécuritaire. De plus, cette décision donne raison à ceux qui pensent que la stabilité apparente en Algérie est soutenue par le chaos au Sahel où ont été déversés des terroristes d’origine algérienne.
Loin d’être un simple outil de dissuasion, cette loi ouvre la voie à une tension permanente, y compris dans les zones frontalières avec d’autres pays, à l’image du Mali, du Niger et de la Libye. Pour autant, le président algérien, lors de son interview à des médias de son pays, dit œuvrer pour le bon voisinage. Son discours contraste avec ses décisions. Ainsi, à défaut de convaincre par le dialogue ou par la coopération, Alger choisit de réaffirmer son autorité par la force du droit martial allant à l’encontre de la doctrine qu’elle ne cesse de prêcher au sein des organisations internationales.
PAR SIKOU BAH
Source : Info Matin
Lire l’article original ici.